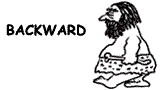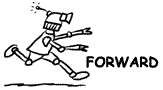1°S3 H.A.M.M.
TPE 2014
Matière noire
Dans le cadre des modèles cosmologiques actuels, la matière est supposée être présente sous deux formes: la matière ordinaire et la matière noire, qui interagit avec le reste des composants de l'Univers uniquement par gravitation. C'est cette dernière forme de matière, supposée composer environ 25% de l'Univers, dont l'existence reste à prouver.
Les indices de la présence de la matière noire
1- Masse de notre galaxie
La première chose qui a permis d'introduire l'idée de la matière noire a été l'estimation de la masse de notre galaxie. Des scientifiques ont découvert que la masse "visible" de la Voie Lactée était trop faible et donc que la gravité due à cette masse était trop faible. Selon leurs calculs, s'il n'y avait que cette masse "visible" la galaxie se serait disloquée et les étoiles se seraient dispersées dans le cosmos. C'est de là qu'est née l'hypothèse de la matière noire, matière lourde et invisible qui permettrait aux galaxies de tenir en place comme nous les voyons aujourd'hui.
2- Vitesse de rotation des étoiles dans notre galaxie
On peut déterminer la masse d'une galaxie en regardant à quelle vitesse les étoiles tournent autour de son centre.
Plus leur vitesse est grande, plus la masse de la galaxie est élevée.


Si l’on suppose que la masse des galaxies résulte uniquement des étoiles qui la composent, on peut prédire à quelle vitesse celles-ci tournent autour du centre de la galaxie. En réalité, on observe les étoiles tourner beaucoup plus vite que ce a quoi l’on s’attend. Cela prouve qu’une partie de la masse des galaxies est invisible. L'étude détaillée de la répartition de cette masse prouve que celle-ci est composée d’une forme de matière inconnue en laboratoire, la matière noire.
Diverses mesures indiquent que cette matière n'est pas formée d'atomes tels que ceux qui composent la matière que nous connaissons : si tel était le cas, cette matière noire serait bien plus lumineuse. Les galaxies contiennent ainsi en quantité considérable une forme de matière inconnue.
Cette matière noire est aussi invisible, c'est à dire qu'elle n'émet aucune lumière et que la lumière émise par une source la traverse totalement : c'est pour cette raison qu'il est très difficile de la trouver. De nombreux chercheurs à travers le monde se sont mis à sa recherche pour pouvoir l'étudier mais la tâche est rude et loin d'être accomplie.
3 - Phénomène de la lentille gravitationnelle
La lentille gravitationnelle est un procédé explicité par Einstein dans la théorie de la relativité générale. Selon lui, il faut se représenter l'Univers comme une grille infiniment grande sur laquelle on dépose des objets compacts et massifs qui vont déformer cette grille suivant leur masse. Si un rayon lumineux arrive au niveau de cette déformation locale de l'espace-temps, ce rayon va suivre le tracé de la grille déformée et donc être dévié : c'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle.
De la même façon qu'on observe une déformation de l'image lorsque des rayons lumineux sont déviés par la présence d'une lentille de verre sur leur trajet, on s'attend à observer une image déformée des étoiles lorsque leur direction est proche de celle d'un objet massif (trou noir, galaxie...).


arc gravitationnel
En 1985, Yannick Mellier et ses coéquipiers - alors qu'ils cherchaient à voir l'évolution des amas de galaxies situés à une grande distance de la Terre - découvrent dans le ciel d'Hawaii une forme étrange qui ne correspondait à rien de connu à l'époque, trop étendue pour être une galaxie et très distordue. On pense alors qu'il s'agit d'un défaut de l'instrument mais Mellier a prouvé grâce à l'effet de lentille gravitationnelle qu'une galaxie se trouvait exactement alignée derrière une autre.
C'est la distorsion des rayons de lumière qui a crée cet arc gravitationnel. Mais son raisonnement va plus loin : il prétend que si les arcs gravitationnels existent, cela signifie qu'il y a assez de masse et de densité dans les galaxies pour dévier la lumière. Or, il n'y a pas assez de masse dans les galaxies pour dévier la lumière de la sorte, on en déduit donc qu'il existe une masse supplémentaire invisible permettant la distorsion des rayons lumineux : la matière noire.
C'est de cette manière qu'une bonne partie des astrophysiciens s'est mise à la recherche et à l'étude de cette matière.
Qui sera la matière noire ?
1- Les nuages de gaz
Dans les années 1990, des cartographies précises des sources d'émission de rayons X dans l'univers — obtenues grâce au satellite Rosat — ont mis en évidence la présence de gigantesques nuages de gaz ionisé au sein des amas de galaxies ; des nuages de plusieurs millions de degrés n'émettant pas de lumière visible. De plus, ces nuages semblaient contenir dix fois plus de matière (du moins, lumineuse) que les galaxies de ces amas.
Peut-être était-ce enfin la matière manquante recherchée ? Malheureusement non. Au contraire même, ces nuages sont la preuve de la présence de matière noire autour des galaxies. En effet, pour atteindre de telles températures, les particules constituant le nuage doivent être accélérées à des vitesses très élevées (environ 300 km/s), et cette accélération provient de la force de gravitation. Or la quantité de gaz est insuffisante pour générer un tel champ de gravité. De même, les étoiles ne peuvent à elles seules empêcher le nuage de gaz de s'échapper. L'influence gravitationnelle de la matière noire est ici aussi nécessaire pour expliquer le confinement de ces nuages à proximité des galaxies. D'ailleurs, la forme de ces nuages peut aider les astronomes à étudier la distribution de la matière noire aux alentours.
2- Les Neutrinos
Détectés en 1956 par Frederick Reines et Clyde Cowan, les neutrinos sont des particules élémentaires - objet de dimension nulle et sans constituants - engendrées par des réactions nucléaires ou des cataclysmes cosmiques lointains et extrêmement violents tels que les trous noirs, les supernovas et le Big Bang. De toutes les particules élémentaires, le neutrino est la seule qui soit dépourvue de charge électrique. Insensible aux forces électromagnétique et nucléaire forte, sa masse est très faible, à tel point qu'elle fut longtemps considéré comme nulle. Mais sa particularité la plus étonnante est sa faculté à traverser la matière.

Détecteur de neutrinos Super-Kamiokande au Japon
Attention les yeux ! Sans nous en apercevoir, chaque centimètre carré de notre peau est traversé chaque seconde par 65 milliards de neutrinos émis au centre du Soleil lors de la fusion de l'hydrogène en hélium !
Du fait de sa très faible interaction avec les autres particules, le neutrino était un candidat parfait pour la matière noire. D'autant plus que le neutrino est la particule la plus abondante dans l'univers, après le photon. Cependant, les expériences réalisés dans deux observatoires de neutrinos : Super-Kamiokande et SNO ont révélé une masse beaucoup trop faible pour que cette particule puisse constituer l'essentiel de la matière noire.
Les neutrinos peuvent représenter, au mieux, 18 % de la masse totale de l'Univers. Belle tentative tout de même...
3- Les trous noirs
Beaucoup plus massifs que les étoiles, les trous noirs auraient pu être de bons candidats. Certains d'entre eux pourraient atteindre une masse de plusieurs millions, voire de plusieurs milliards de masses solaires - la masse du Soleil étant de
1,989 x 1030 kg - notamment les trous noirs supermassifs, au centre des galaxies. Cependant, il faudrait dans une galaxie, près d'un million de trous noirs d'une telle masse pour combler ce manque de matière ; un nombre trop important au vu des conséquences sur les étoiles à proximité d'un trou noir.
En effet, les trous noirs traversent par moment le disque galactique et perturbent le mouvement des étoiles. Avec un tel nombre de trous noirs, les mouvements de ces étoiles seraient fortement amplifiés, ce qui rendrait le disque galactique bien plus épais que ce qui est observé actuellement. Restent les trous noirs stellaires (de l'ordre de quelques masses solaires), difficilement détectables, et les trous noirs de quelques dizaines ou centaines de masses solaires, dont la nature de la formation reste encore mystérieuse. Dans tous les cas, la piste des trous noirs comme étant la fameuse matière noire a été délaissée, et les astronomes se sont penchés sur d'autres théories telles que les WIMP ou encore les MACHO.

Et s'il n'y avait pas de matière noire ?
Plusieurs scientifiques ne croient pas à l'existence de cette mystérieuse matière noire et ont des théories bien différentes de celle-ci. Comme toute théorie sans preuves irréfutables, celle de la matière noire a ses détracteurs.
MOND : La naissance d'une théorie révolutionnaire
Comprendre par le calcul :
Pour comprendre de quoi il en retourne, commençons par rappeler qu'en physique newtonienne, le cas simple d’une grande masse M attirant une plus petite masse m située à une distance r de la première est décrit par la relation bien connue, où a est l’accélération du petit corps et G est la constante de la gravitation de Newton :
Milgrom a introduit un facteur qui dépend de a où a0 est une nouvelle constante universelle telle que :
Lorsque l'on est proche du corps central et que l'accélération a de la masse m va être grande devant a0, le facteur vaut 1 et l'on retrouve la physique de Newton. Mais lorsque l'on se trouve à de plus grandes distances telles que l'accélération a est faible devant a0, ce facteur change et devient proportionnel à a/a0, de telle sorte que l'accélération a n'est plus donnée par la loi de Newton, mais par :
Voilà toute la différence !
Et si Newton s'était trompé ?
"Il n'y aucun besoin de matière noire dans l'Univers" et si beaucoup d'experts continuent à y croire, "c'est parce que c'est leur gagne-pain, leur revendication à la célébrité. Ils ne changeront jamais d'avis". Depuis le début des années 1980, l'astrophysicien de l'Institut Weizmann, Mordehai Milgrom n'en démord pas. Pour lui, l'Univers est bien tel qu'on le voit, c'est à dire constitué de grands espaces vides ponctués par des amas de galaxies. Et sans aucune masse invisible, sans la matière noire !
Cette conviction, il l'acquière des 1983, lorsqu'il découvre qu'une toute petite modification de la loi de la gravité de Newton suffit à résoudre l'un des problèmes fondamentaux de la cosmologie : la rotation trop rapide des étoiles et des galaxies. En effet, la constante gravitationnelle n'est déterminée qu'à quelques pourcents près et de plus, la gravité est une force faible jamais encore testée sur de très courtes ou très longues distances.
Si les vastes spirales scrutées par les grands télescopes tournent aussi vite, ce n'est pas parce qu'elles sont sous l'emprise d'une masse indétectable, mais bien parce que la loi de la gravitation universelle n'est pas celle que l'on croit ! D'un seul coup, grâce à sa théorie qu'il baptise MOND ( pour Modified Newton Dynamics ) il parvient à éliminer tout recours à la matière noire.

Milgrom s'est permis audacieusement de faire une toute petite entorse à la fameuse loi de Newton. Au lieu de laisser la force d'attraction entre deux corps décroître comme le carré de leur distance, il imagine qu'au delà d'une certaine distance, la gravitation diminue beaucoup moins vite. Surprise ! Tout rentre alors dans l'ordre : les étoiles de la périphérie des galaxies tournent bien à la vitesse prescrite.
Mais les détracteurs de MOND gardent un argument de poids. La véritable théorie de la gravitation est celle donnée par Einstein, la loi de Newton n'en est qu'une simplification. Puisqu'on la change, il faut aussi modifier la relativité. La tache semble surhumaine et on croit MOND enterré sans rémission.

Le récent renouveau de la théorie vient d'un chercheur américain, Jacob Beckenstein. Pendant plus de 20 ans, il tente d'insérer MOND dans la relativité... et trouve finalement la solution en 2004. Au prix d'une modification un peu plus complexe et de l'introduction de 3 nouveaux paramètres, il montre que MOND reste en accord avec Einstein. La gravité modifiée marque deux grandes victoires : - elle permet d'expliquer les mirages gravitationnels et encore plus spectaculaire
- elle peut reproduire assez fidèlement les inhomogénéités du fond diffus cosmologique mesuré par le satellite WMAP en 2005.
Le débat sur la théorie MOND est très vif mais il faut reconnaitre que cette dernière a marqué des points.